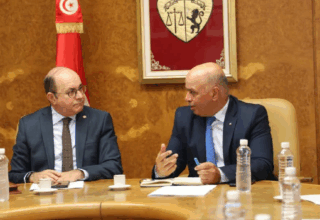Artiste complet ayant plusieurs cordes à son arc, le poète , peintre, pianiste, monteur de spectacles musico-poétiques, illustrateur de livres, animateur d’ateliers d’écriture et critique littéraire, le co-auteur d’un nouveau joyau «Au jardin», Patrick Navaï, poursuit passionnément ses fabuleux voyages scripturaires et picturaux à travers les chemins de la création qui est chez lui un dialogue substantiel entre le rythme et l’image, entre les mots et les encres multiformes, de multiples couleurs donnant de l’épaisseur à la signification et multipliant le coefficient de l’émotion.
«Au jardin» est le titre de ce délicieux nouveau recueil de poèmes que Patrick Navaï vient de composer et de publier avec Jacqueline Persini et où sa voix chuchotant tel le vent de l’été alterne avec celle, rêveuse, de cette remarquable poète française postmoderne, mais en même temps avec ses propres illustrations en encre de chine qu’il a soigneusement réalisées et qui interagissent subtilement avec cette trentaine de pages majoritairement blanches au milieu desquelles flottent de courtes strophes (des quintils) aux vers souvent courts et au rythme lent que des suspensions et des trous dans la chaîne morphosyntaxique ou des silences intermittents ralentissent davantage pour favoriser la méditation quelque peu mystique et la communion amoureuse avec la nature. Une poésie délicate, lapidaire, en demi-teinte, écrite à deux plumes pour faire écouter le battement de deux cœurs qui ne se rencontrent, dans ces syllabes rigoureusement pesées et comptées, que pour essayer de faire jaillir de la tension osmotique du désir verbal «L’ultime source/ blottie au creux/ des ombres», le «songe replanté la nuit» et «les envies de paradis» (Monrouge, Voix Tissées, coll. «C’est-à-dire», 2022)
Artiste complet ayant plusieurs cordes à son arc, le poète , peintre, pianiste, monteur de spectacles musico-poétiques, illustrateur de livres, animateur d’ateliers d’écriture et critique littéraire, le co-auteur de ce joyau, Patrick Navaï, poursuit passionnément ses fabuleux voyages scripturaires et picturaux à travers les chemins de la création qui est chez lui un dialogue substantiel entre le rythme et l’image, entre les mots et les encres multiformes, de multiples couleurs donnant de l’épaisseur à la signification et multipliant le coefficient de l’émotion.

Après «L’écho des dits», «les cœurs apostrophés», «Shams le musicien», «Les amoureux du Danube», «Le parfum de Marie de Magdala», il a publié, au cours des dernières années, aux précieuses éditions artisanales «Carnets-Livres», coup sur coup, ses 3 recueils majeurs «Voyages encrés», «Les chemins contrariés» et «Confidences encrées».
Français, de père iranien, il vient de voir se réaliser l’un de ses vœux les plus chers qui est la traduction à la langue persane de deux de ses livres. Une traduction importante établissant les ponts entre lui-même et le féérique pays paternel et dont s’est chargé, avec brio, le professeur de littérature française et Doyen de la Faculté des Lettres à l’Université de Téhéran, Mohammad Ziar, qui est lui-même poète à ses heures. Différents mémoires de recherche ont été soutenus, sur ce poète français aux racines iraniennes, aux Universités de Téhéran et de Sousse. La Ville de Paris lui a accordé sa Médaille (échelon Vermeil), en reconnaissance de son œuvre artistique remarquée. Le réalisateur français, Patrice Velut, lui a réservé différents courts-métrages qui circulent sur la chaîne numérique «Youtube». Interview :
Commençons par votre nom de famille et sa signification : «Navaï!». Ce n’est pas un nom français, contrairement à votre prénom ?
Navaï est un mot persan qui signifie le mélodieux et littéralement celui ou celle qui est habitée par la mélodie. C’est aussi un mode musical (nava) faisant partie du répertoire traditionnel de la musique persane. Mon père Amir Houcheng Navaï, m’a raconté, dès l’enfance, que notre famille descend de Mir Ali Shir Navaï (1441-1501), de ce célèbre poète soufi, enlumineur et musicien né à Hérat (ville aujourd’hui afghane). Il fut l’auteur de nombreux ouvrages en langues turque et persane et vécut, en tant que vizir, à la cour de Samarkand. En Ouzbékistan, notamment à Tashkent, existent l’Opéra Navaï, le Musée Navaï, sans parler des nombreuses avenues qui portent son nom ou statues qui le représentent. Il est l’équivalent d’un Victor Hugo. Navaï est aussi le nom d’une ville ouzbèk de plusieurs milliers d’âmes, située entre Boukhara et Samarkand.
Mais il existe en Iran un village qui s’appelle Nava. Quant à mon prénom Patrick, c’est ma mère d’origine picardo-bretonne qui me l’a attribué. Dans l’histoire religieuse, c’est lui qui a évangélisé l’Irlande. D’où une résonance celtique…
Dans l’avant-propos de votre recueil «Confidences encrées», vous écrivez : «Je voyage de plus en plus dans une langue, le français, qui s’avère pour moi de plus en plus multiple : elle contient toutes les langues de l’humanité. Même le persan, ma langue paternelle…». Comment pourrait-on comprendre cette déclaration du Franco-Iranien que vous êtes ? Comment cette langue de Molière serait-elle multiple et contiendrait toutes les langues de l’humanité ?
La langue française est constituée de nombreux mots étrangers : des mots latin, grec mais aussi anglais, créole, arabe, turc, persan, etc. Sans lesquels nous ne pourrions nous exprimer. Car, comme le dit la linguiste Henriette Walter dans l’interview que nous avons faite pour le premier numéro de la revue Migraphonies : «…Une langue pure n’existe pas, c’est un mythe. Les langues s’attirent mutuellement. On emprunte ce dont on a besoin».
Citons quelques mots issus d’autres langues qui sont venus enrichir le français comme de l’arabe : safran, alambic, alcôve, alcool, algèbre, jarre, moire, nacre, zénith, matelas, magasin, gazelle, mousseline, café, galère, girafe, récif, nuque, sirop, zéro, tabac, talisman, etc. Ou de l’espagnol : parade, guérilla, mérou, sieste, tango, cargo, casanier, junte, compliment, estrade, vanille, transhumer, embargo, mousse, jonquille, résille, etc. Ou du japonais : bonze, soja, kamikaze, dan, kimono, samouraï, judo, geisha, karaté, kaki, etc. Ou du sanskrit : cramoisi, muguet, punch, yoga, muscat, carmin, jungle, laque, jute, mandarine, riz, nirvana, lilas, etc. Giovanni Dotoli ; professeur à l’Université de Bari a écrit dans son livre Le français, une langue d’Orient ?
En composant vos vers et poèmes, quel rapport établissez-vous avec la langue : un rapport de destruction, suivi par une reconstruction nouvelle et différente, comme chez beaucoup de poètes de la modernité, ou un rapport ordinaire fondé sur la norme logico-syntaxique établie ? En plus clair, est-ce que vos poèmes sont le fruit d’un élan spontané, une espèce d’inspiration ou le produit d’un patient et long travail sur les mots et les formes langagières ?
Dans ma jeunesse, pour mieux fixer certains états de conscience et d’inconscience, j’ai eu recours au sonnet. Je travaillais alors beaucoup la forme. Il faut dire que j’ai été latiniste et j’éprouvais du plaisir à interroger l’étymologie des mots. C’est ainsi que je me suis rendu compte que la langue française était nourrie, outre les mots latins et grecs, de mots arabes, persans, turcs et de bien d’autres encore. Mais beaucoup de mes poèmes sont nés sous le fruit «d’un élan instantané», lors de mes nuits blanches. Je me sens profondément lyrique et le revendique à haut cri. Le lyrisme est le chant. Sans lui, nous pouvons mourir. Il fait partie de la vie, tout comme en font partie l’air, l’eau, le feu et le vent. L’Occident, sans lui, s’étoufferait, prisonnier qu’il est déjà du matériel. Les poètes, ces singuliers oiseaux qui nous font voir au-delà des mers et de l’horizon, restent l’espoir d’un Occident devenu trop épris des sciences et des techniques.
Est-ce que vous auriez aimé pouvoir écrire dans la langue de votre père ? Pourquoi ? Est-ce que cette langue vous manque ou vous indiffère ?
Cette langue me manque et me manquera toujours. Pourtant bien des mots français auxquels j’ai recours inconsciemment pour écrire sont d’origine persane.
Pourrait-on penser que la poésie constitue pour vous une espèce de revanche sur l’ordre des choses qui vous a séparé de l’Iran de votre père, puisque vous ne cessez de chanter ce pays absent et lointain ?
En fait, l’Iran n’est pour moi ni absent ni lointain. Il est là au fond de moi, dans mes yeux, dans ma tête et dans mon cœur qu’il fait souvent battre. Quand je parle de l’Iran, j’entends toute cette zone géographique physique et culturelle qui va de l’Iran à l’Afghanistan, au Tadjikistan et même en Ouzbékistan. La poésie est un art qui me permet de parler aux habitants de cette région du monde et, bien sûr, aux membres de ma famille.
Comment trouvez-vous la place qu’occupe la femme dans votre poésie et dans votre peinture ?
Comme je vous le disais plus haut, la femme a une place prépondérante déjà dans ma peinture. Je la représente bien plus grande que les hommes : elle les domine en taille et en beauté. Nous pouvons y voir une réminiscence des anciennes déesses comme Ishtar, Anahita, Ana, etc. De plus, dans mon conte Dalma et Nimrod, les amoureux du Danube, c’est la jeune fille qui se démène pour trouver la solution au problème posé par le fleuve qui la sépare de l’élu de son cœur. Elle va demander conseil, et après avoir réfléchi et rencontré la bonne personne, elle va permettre grâce à un stratagème à son amoureux de la rejoindre.
Quel est le terme que vous choisirez pour décrire votre rapport à la Femme en général : émotion, rêves, création, douleur ou manque ?
Tous ces termes que vous citez avec justesse décrivent ce que je ressens vis-à-vis de la femme. En fait, j’ai longtemps comparé la femme à une déesse et ai toujours voulu la mettre sur un piédestal, voire lui dresser un temple où elle officierait. Peut-être parce que je rêve d’un monde matriarcal en raison des désastres, des guerres et des violences psychologiques que la plupart des Etats dirigés par des hommes ont apporté à l’humanité et à la planète Terre. Quand nous rencontrons et aimons une femme, nous assistons à une nouvelle naissance de nous. Je choisirai le mot alors naissance. Elle est source de toute vie humaine. Sans elle, nous, hommes, n’existerions pas. Pourquoi alors les hommes s’en sont pris à elle, l’ont dénigrée, l’ont réduite à un objet de consommation sexuelle et de reproduction et cela depuis des millénaires ?
Mon recueil paru aux Editions «Voix Tissées» est dédié à une femme mille fois réincarnée à travers les âges et il a pour titre Le parfum de Marie de Magdala et a été illustré par les magnifiques peintures de Lionel Rigault. Je l’ai écrit lorsque je me trouvais en résidence d’écrivain à la Maison Jules Roy à Vézelay. Il faut que celle-ci se trouve toute proche de la Basilique Marie-Madeleine. Cette femme, Marie de Magdala ou Marie Madeleine, ne cesse, depuis des siècles, d’inspirer les artistes, les historiens et les croyants de diverses religions dans le monde entier. Des centaines de milliers de voyageurs viennent lui rendre hommage, chaque année, car elle se trouve sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
«La femme est l’avenir de l’homme», disait Louis Aragon dans un célèbre poème qui a été chanté par Jean Ferrat. Etes-vous d’accord sur cette assertion ? Pourquoi ?
Oui, la femme est bien l’avenir de l’homme. Regardons ce qu’ont causé les hommes au cours des siècles : cumul des pouvoirs religieux et étatiques et d’incessantes guerres. Qui ont manifesté de tout temps contre les horreurs et les destructions engendrées par les chants martiaux et viriles ? Ce sont les femmes ! Parfois au péril de leur vie en s’interposant sur le champ de bataille entre les belligérants. Battant le pavé, écrivant des pétitions au Ministère de la guerre pour réclamer la fin des conflits. Peu d’entre elles ont été entendues tellement la haine a animé et anime encore la poitrine des hommes alors que nous savons qu’elles sont les premières victimes de la guerre (outrages, viols). Les sociétés patriarcales avaient exclu et continuent d’exclure, dans certains points du globe, les femmes du savoir. Elles les ont longtemps confinées dans leur foyer, vouées uniquement à l’éducation des enfants et aux tâches ménagères. Bien d’entre elles se sont révoltées contre leurs conditions de vie, d’autres sont entrées en révolution. Ce qui a abouti à l’égalité des droits entre femmes et hommes, reconnue par la loi. Et encore de nos jours, dans les Etats où les lois ont été votées, leur application laisse à désirer. La violence habite les hommes : il n’y a qu’à constater le nombre de ceux-ci dans les prisons du monde entier : près de 90%. Pour vol, agression, viol, meurtre. Et souvent contre leur propre épouse, fiancée, mère, sœur… La misogynie est le pire des racismes qui puisse exister au monde car il est le plus meurtrier car elle s’exerce sur la moitié des habitants de la planète.
Vos recueils sont souvent illustrés par de nombreuses peintures réalisées par vous-même. Ces peintures sont-elles là pour remplir une simple fonction décorative ou ornementale ou sont-elles en interaction avec vos poèmes qui les complètent ou prolongent ou éclairent ? Votre peinture assume-t-elle la tâche de dire les non-dits, l’implicite et le silence qu’on pourrait circonscrire dans votre poésie ?
Parfois mes peintures ouvrent des espaces inédits, parfois elles sont en résonance avec mes poèmes. Parfois elles déclenchent le poème. Aujourd’hui je constate qu’elles ont fait leur chemin : une centaine d’entre elles est entrée dans cinq musées dont le Musée International d’Art Naïf, Anatole Jakowsky de Nice ou le Musée de La Poste de Paris.
Comme dans vos peintures, il y a beaucoup de poissons dans vos poèmes. Le poisson serait-il l’un des symboles constants, voire obsédants de votre univers poétique ? Vient-il d’un mythe personnel ? Aurait-il quelque rapport avec la culture persane ?
Je vous répondrai par ce qu’a écrit l’universitaire Reza Afchar Naderi à propos du poème Le poisson d’Ahmad Shamlou dans son livre Poètes libertaires d’Iran : «L’image du poisson est omniprésente, aussi bien dans la culture poétique que dans le quotidien des Iraniens. Il hante les profondeurs des bassins intimistes de vieilles demeures persanes. Symbole de fécondité, il est pénétré par les forces sacrées qui remontent de l’abîme».C’est une question que les gens me posent beaucoup. Pour moi, le poisson est un messager qui vient vers nous pour nous apporter un rêve, une réponse à un questionnement existentiel, un remède à une maladie ou, à l’inverse, un cauchemar qui est le reflet de ce que nous vivons. Il est là pour nous montrer où se trouve le danger. J’ai une origine bretonne par mon grand-père qui était issu d’un village tout proche de la mer…
Les poissons m’ont toujours parlé et souvenons-nous de notre origine marine, de l’eau du placenta maternelle…Il suffit de tendre l’oreille pour entendre les mélodies des poissons que ces derniers émettent au sein des rivières, des fleuves, des lacs et des océans.
Dans «Voyages encrés», suivi de «Les chemins contrariés» (Carnets-Livres, 2010), outre le poisson qui envahit vos poèmes de partout, il y a aussi une importante présence des sirènes auxquelles vous avouez avoir «toujours eu un penchant» (page 10). Comment expliquez-vous cet intérêt à cet être fabuleux, mi-femme, mi-poisson ?
Les cosmogonies, les mythes et légendes qui expliquent la naissance du monde, de la terre, des rivières, des arbres, des montagnes par l’activité des dieux et des déesses ont la particularité de me ravir. Et souvent ces êtres sont mi-animal mi-humain. Comme c’est le cas de la sirène: mi-femme mi-poisson comme vous l’avez relevé. La sirène dans l’Odyssée est une créature maléfique qui veut entraîner dans la mort les marins en leur chantant des mélodies enivrantes. Mais ce n’est pas aux sirènes grecques que je fais appel dans mes écrits ou mes peintures. Je retiens d’elles seulement le fait qu’elles sont irrésistibles encore que, dans cette épopée, seul Ulysse trouve le moyen, en s’attachant au mat du bateau, d’échapper à leurs tentations mortifères. Pour moi, les sirènes ne sont plus aujourd’hui dangereuses pour les humains, je ne retiens que leur beauté et leurs chants mélodieux irrésistibles…
Dans le cadre de «La Société Littéraire de La Poste et de France Télecom» et avec la contribution active de Anne-Marie Bence et d’autres poètes dont Sylvie Forestier et Isabelle Le Bouig, vous avez adapté plusieurs de vos poèmes en une pièce musicale et poétique que vous avez jouée en 2012, au studio Raspail, à Paris. Cette adaptation vous a-t-elle été aisée ? Trouvez-vous que le poème est mieux perçu et senti quand il est chanté ou déclamé au théâtre que quand il est lu dans un livre ou un journal ?
Anne-Marie Bence, qui est rédactrice en chef de la revue «Missives», a eu la merveilleuse idée, en 2012, de réunir des poètes d’univers fort différents et un musicien poly instrumentiste, le jeune Yvan Navaï, pour adapter nos poèmes à la scène. Elle est une grande ambassadrice de la poésie et je lui suis profondément reconnaissant pour les efforts titanesques qu’elle accomplit pour faire connaître la poésie dans une époque qui en est trop souvent dénuée. J’avais déjà eu, par le passé, l’occasion de jouer le rôle du narrateur à l’Unesco en 2003 pour un spectacle intitulé «Mille et un poèmes pour la paix en Afganistan» et de déclamer mes poèmes dans divers lieux culturels. Mais, quand on n’est pas soi-même comédien, on prend toujours un risque énorme. Pourtant, à chaque fois, la volonté de transmettre s’avère plus forte que le trac qui nous menace. Il faut une réelle entente avec les autres comédiens et assurer suffisamment de répétitions pour que cela fonctionne. Il n’est pas aisé pour moi de dire mes propres poèmes, car je n’ai pas suffisamment de distance par rapport à eux ; je peux toujours, à un moment ou un autre, être piégé par l’émotion, par la chair des mots, par leur enveloppe sonore. Et pourtant je reconnais que la magie opère à mon plus grand étonnement et transcende tous les doutes de l’être. Car les poèmes sont mis en interaction avec d’autres et mis en relief avec la musique. Néanmoins je reste persuadé que lire un poème dans un livre ou un journal procure autant de jouissance et d’intelligence et permet d’apprendre autant sur soi et sur le monde que de le vivre au théâtre.